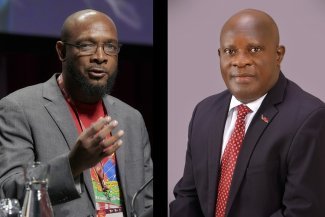Un dimanche soir, en décembre 2012, une étudiante de médecine de 23 ans rentrait du cinéma accompagnée d’un ami lorsqu’ils furent attaqués par un groupe d’hommes à bord d’un autobus. Elle fut violée à plusieurs reprises et est plus tard décédée. Son ami fut battu avec une barre de fer.
L’incident déclencha une vague de manifestations massives réclamant l’adoption de mesures plus strictes. Les trois agresseurs furent condamnés à mort et en mars de l’année suivante, le gouvernement passa une loi qui élargissait le champ des crimes sexuels en y incluant la pénétration forcée à l’aide de n’importe quel objet, le harcèlement, les attaques à l’acide et le déshabillage forcé.
La législation fut adoptée suite à la publication d’un rapport de la Commission présidée par le juge Verma, qui évoquait « l’échec du gouvernement à garantir aux femmes de l’Inde, qui sont constamment exposées à la violence sexuelle, un environnement sûr et digne ».
Depuis l’attaque, on assiste à une augmentation du nombre de cas signalés de viols en Inde. D’après le National Crime Records Bureau, 337.922 plaintes pour violence, y compris viols, maltraitances et enlèvements, contre des femmes ont été déposées en 2014, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à 2013.
Le nombre de viols ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte dans le pays a, lui aussi, augmenté de 9%, à 33.707 cas enregistrés en 2014.
D’aucuns estiment, cependant, que le viol n’est toujours pas pris suffisamment au sérieux. Le viol conjugal reste autorisé par la loi. La ministre indienne des Femmes et du Développement de l’enfance, Maneka Gandhi, a récemment soutenu que le viol conjugal ne pouvait être criminalisé car la société indienne considère « le mariage comme un sacrement ».
L’année dernière, une femme de 28 ans, victime de violence domestique qui avait déjà déposé des plaintes contre son mari, a soumis une requête à la Cour Suprême demandant l’abrogation de l’exemption du viol conjugal. Sa requête a été infructueuse. Une seconde requête introduite par plusieurs organisations des droits des femmes a également été retirée.
Des progrès, oui, mais la route est longue
Selon Runjuna Kumari, l’une des principales militantes des droits des femmes en Inde et directrice de l’ONG Center for Social Research à New Delhi, bien que les statistiques nationales soient nettement inférieures à la réalité sur le terrain, de plus en plus de femmes osent dénoncer les cas de violence.
« Le chiffre a été multiplié par deux à Delhi. Bien que cela reste insuffisant, il s’agit néanmoins d’un progrès par rapport au passé », indique madame Kumari lors d’un entretien avec Equal Times. « La loi est devenue très stricte et offre une définition très large du viol. Le cadre de sanction est, lui aussi, extrêmement rigoureux.
« Nous avons traité ce genre de cas depuis plus de 30 ans mais à présent les gens sont plus vigilants et les médias sont beaucoup plus réactifs », dit-elle. « Les gens n’hésitent pas à participer à des manifestations. La situation a changé. »
Cependant, la stigmatisation sociale demeure monnaie courante, a fortiori lorsque la violence sexuelle à lieu à l’intérieur du cadre familial, explique Runjuna Kumari. Encore aujourd’hui, les policiers ont souvent tendance à ne pas prendre au sérieux les plaintes pour violence et à rejeter la faute sur les victimes.
Durant un appel vidéo avec Equal Times, madame Kumari a dû, à plusieurs reprises, interrompre l’entretien pour répondre à des appels téléphoniques concernant le cas d’une fille qui, la nuit antérieure, avait été violée dans la rue dans le sud de l’Inde.
« Les policiers affirment que nous exagérons [les faits] or ils font tout pour les étouffer. Nous devons déposer des plaintes comme celle-ci encore et encore », dit-elle.
La police indique que la victime n’a pas signalé l’incident mais d’après madame Kumari, les femmes ont souvent trop peur de le faire. « Elles seront tenues responsables et on leur demandera « Pourquoi étais-tu vêtue ainsi ? Quel était ton rapport avec l’homme ? Que faisais-tu dans la rue à cette heure ? »
D’après elle, pour que la situation change, il faudra plus de femmes aux positions de pouvoir.
« Plus il y aura de femmes aux positions de pouvoir, aux directions d’entreprises ou en politique, plus elles auront d’influence sur la législation. Entre temps, les violations de ce genre se poursuivront car nous nous trouvons toujours du côté des demandeurs, à réclamer une protection et une intervention de la police. »
Pas seulement en Inde
La violence sexuelle à l’égard des femmes est un problème de portée mondiale. Aux États-Unis, les agressions sexuelles font chaque année près de 293.000 victimes. Là aussi, la part des agressions sexuelles faisant l’objet du dépôt d’une plainte est extrêmement faible, d’après le Rape Abuse and Incest National Network, selon lequel 68% des cas ne sont pas signalés et seulement 2% des violeurs purgent des peines de prison.
Selon un rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), la violence sexuelle touche approximativement 35% des femmes en République tchèque, 28% au Danemark, 13% en Allemagne et 17% en Pologne.
Toujours selon le même rapport, entre 1 et 12% des cas de viol en Europe font l’objet d’une plainte, alors qu’une proportion encore plus réduite de cas donnent lieu à des poursuites.
Si l’Inde se trouve sous les feux de la rampe c’est parce que de plus en plus de femmes s’insurgent contre la violence sexiste et parce que les médias couvrent régulièrement les cas de viol.
Nonobstant, la culpabilisation des victimes reste endémique. Pour la photoreporter indienne Smita Sharma, même s’ils couvrent les cas de violence, le manque de sensibilité qu’affichent les médias indiens dans leurs reportages n’est pas propice à un changement des mentalités ; Les reporters de télévision vont souvent fouiner dans des détails macabres comme les vêtements que portaient les victimes au moment du viol.
« Les médias indiens suivent ces cas mais pas autant qu’ils devraient. Ils ne montrent jamais le point de vue des survivantes et les difficultés que celles-ci affrontent », dit-elle.
« Personne ne tente de découvrir pourquoi les hommes se conduisent de cette façon. Il y a toujours une excuse pour rejeter la faute sur les femmes et justifier les actions des hommes. »
Smita Sharma a donc décidé de photographier les victimes de viol et de suivre leurs cas pour en savoir plus sur ce qui arrive après leur calvaire. Au terme d’entretiens avec une trentaine de victimes, elle a pu déterminer que dans 90% des cas, les faits n’avaient pas été dénoncés.
La photographe de 35 ans qui partage son temps entre Calcutta et New York se prépare à présent à tourner un film qu’elle projette de diffuser dans les régions rurales de l’Inde. Sa récente campagne Kickstarter lui a permis de décrocher des appuis financiers à hauteur de 30.000 USD auprès de plus de 400 donateurs, qui devraient lui permettre de donner vie à son projet.
« Il donnera voix au chapitre à ces filles et à ces femmes et forcera les gens à réfléchir », indique Smita Sharma. « Je veux les montrer en tant que combattantes, qu’héroïnes. »
Elle a aussi fait équipe avec la police de la ville d’Hyderabad, dans le sud de l’inde, pour soutenir les effectifs féminins ou « She Teams ». Ce contingent créé en octobre 2014 se compose de femmes-policiers qui, armées de caméras cachées, patrouillent en secret la ville en tenues civiles pour combattre le harcèlement des femmes dans l’espace public.
Dans le cadre du projet, Smita Sharma veut équiper les filles de bicyclettes pour empêcher qu’elles ne décrochent de l’école par crainte d’agressions sexuelles, attendu que beaucoup de viols surviennent sur le chemin de retour des filles de l’école.
Red Brigades
Ces dernières années ont vu se multiplier en Inde les campagnes en aide aux victimes de la violence, de lutte contre la stigmatisation sociale et de pression en faveur de l’adoption par le gouvernement de lois plus strictes, ainsi que pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.
La Right to Pee campaign (littéralement « campagne pour le droit à faire pipi ») consiste en une initiative collective d’activistes et d’œuvres de bienfaisance qui luttent pour un meilleur accès à des toilettes gratuites et propres pour les femmes.
D’autres initiatives sont également en cours, comme celle des Red Brigades ou brigades rouges à Lucknow, ville du nord de l’Inde. Ce collectif exclusivement féminin enseigne les techniques d’autodéfense aux femmes et aux jeunes filles et mène des actions ciblées contre les auteurs d’agressions sexuelles.
« Nous commençons par nous adresser directement à l’homme. Ensuite, nous allons parler à ses parents. La troisième étape consiste à nous rendre au commissariat de police », indique lors d’un entretien avec Equal Times la fondatrice de Red Brigade, Usha Vishwakarma, 27 ans. « Si l’homme ne reconnaît toujours pas son tort, nous enclenchons la phase d’action. »
Durant la « phase d’action », des groupes de quatre ou cinq brigadistes rouges infligent une correction et humilient en public l’agresseur.
Bon nombre des jeunes femmes de l’équipe sont elles-mêmes des victimes de viol et de violence sexiste, y compris Usha Vishwakarma. Elle a fait l’objet d’une tentative de viol par un collègue enseignant et a seulement réussi à s’échapper parce que les jeans qu’elle portait étaient trop difficiles à enlever. Cette expérience terrifiante a probablement joué dans son engagement à combattre la violence sexuelle sur une plus grande échelle.
D’après madame Vishwakarma, les Red Brigades, qui ont commencé avec un contingent de 15 membres en 2011 comptent aujourd’hui 55 « action girls » et plus de 8000 membres à travers l’Inde. Une partie importante du soutien qu’elles offrent consiste à aider les victimes à réaliser que la violence qu’elles ont subie n’était pas de leur faute.
Purnima Nagaraja, une psychiatre renommée d’Hyderabad qui a travaillé avec des milliers de victimes de viol depuis 1992 confie que la plupart des femmes qu’elle reçoit ignorent le fait qu’elles ont été violées et dans certains cas, ne sont même pas conscientes de la violence qu’elles ont subie.
« Elles viennent pour autre chose, par exemple des troubles alimentaires ou une dépression, puis on remonte à la source, et elles ont été violées et maltraitées », indique la psychiatre.
Bien qu’elle reconnaisse que l’Inde dispose désormais de lois plus rigoureuses, madame Nagaraja estime que le pays devrait accorder plus d’attention à la « sensibilisation en matière d’égalité hommes-femmes ».
Elle a confié, lors d’un entretien avec Equal Times : « Notre travail ici [dans la clinique Dhrithi Psychiatric Care fondée par le docteur Nagaraja] consiste à autonomiser les femmes, en les armant des connaissances dont elles ont besoin pour comprendre qu’elles n’ont pas à subir ça. »
Selon Shazneen Limjerwala, psychothérapeute et auteur du livre The Aftermath of Rape in Gujarat : The Dialectics of Voice and Silence, l’Inde doit rendre les services médicaux, juridiques et sociaux plus accessibles, tout en facilitant aussi l’accès aux aides potentielles.
« Le système judiciaire lui-même perpètre une nouvelle fois la violence en raison de l’extrême lenteur du suivi et du laxisme avec lequel la question est traitée », dit-elle. « Il faut que les gens soient informés des lois. Actuellement, le simple fait de recourir au représentant juridique est un processus chargé de peur et d’opprobre. »
Vous pouvez voir une sélection d’images du reportage photo « Chroniques du courage », de Smita Sharma, en Equal Times.