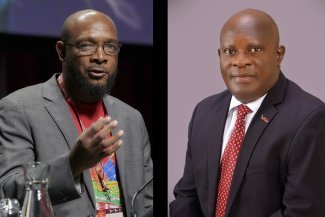De jeunes migrants afghans, dont des mineurs, survivent dans un petit campement de fortune à Calais, en attendant de réussir à passer en Angleterre. Décembre 2020.
Ce matin de décembre, le convoi des forces de sécurité s’arrête à l’entrée d’un terrain vague, le long de la voie ferrée à Calais, dans le nord de la France. L’endroit est connu pour servir de refuge à une vingtaine de migrants afghans, dont certains sont mineurs. Policiers et gendarmes s’enfoncent dans les buissons pour forcer les exilés à quitter les lieux. Les tentes et les sacs de couchage que ces derniers n’ont pas eu le temps d’emporter sont saisis par les agents du service de nettoyage. Il est 10h du matin et c’est la quatrième expulsion de campement de la matinée.
Un périmètre de sécurité tient journalistes et humanitaires à distance. Deux bénévoles du collectif Human Rights Observers (HRO) tentent de filmer la scène avec leur téléphone portable. « On nous bloque systématiquement », témoigne Pénélope Gambi. « On ne peut pas voir ce qu’il se passe pendant l’opération et on ne peut même plus discuter avec les personnes exilées. Normalement, on essaye de leur parler pour savoir quelles affaires ont été emmenées, de quoi elles ont besoin ».
Depuis 2017, les équipes de HRO essaient d’être présentes lors des expulsions et de documenter les opérations de police. Leur méthode de travail s’inspire de celle du « copwatching », apparue aux États-Unis : la surveillance de la police. « La préfecture n’aime pas qu’on soit là. Mais on ne viendrait pas s’il n’y avait pas de violation des droits fondamentaux des exilés au moment des expulsions », affirme Chloé Smidt-Nielsen, la coordinatrice de HRO.
Les policiers sont régulièrement accusés de violence lors des évacuations et de destructions de biens. « Parfois, ils lacèrent des tentes alors qu’il y a encore des personnes à l’intérieur », poursuit Chloé Smidt-Nielsen.
Deux adolescents afghans de retour du centre-ville s’approchent du campement cerné par les gendarmes, qui les empêchent de récupérer leurs affaires. « Ils ont détruit notre tente et emmené nos sacs de couchage, ainsi que tous nos vêtements. Il ne nous reste plus rien », soupire Mustafa, 17 ans, en regardant les véhicules des forces de l’ordre et les camions de nettoyage quitter les lieux. « Ils sont mineurs, donc ils devraient être pris en charge, mais non, ils sont laissés comme ça, et la police ou l’équipe de nettoyage prennent leurs affaires quand même », s’indigne Pénélope Gambi.
Une partie des biens saisis lors des évacuations part directement à la déchetterie. Le reste est stocké sans ménagement dans un container où les exilés peuvent venir les récupérer, à condition d’être accompagnés par un membre d’une association. Malek, l’un des Afghans expulsés un peu plus tôt, extirpe une tente et son sac à dos du tas d’affaires sales. « C’est très dur pour nous », raconte le jeune homme dans un très bon anglais. « On n’a pas d’endroit où dormir. On dort dans la « jungle ». La police ne devrait pas venir prendre nos vêtements. Tous les deux jours, on doit marcher sous la pluie jusqu’ici pour les récupérer, ce n’est pas juste ».
Calais, point de transit depuis plus de vingt ans
Depuis plus de vingt ans, les exilés affluent à Calais dans l’espoir de gagner l’Angleterre. Les premiers camps de migrants apparaissent à l’hiver 1998. Pour accueillir ces personnes originaires principalement du Kosovo, la Croix-Rouge ouvre un centre dans la ville voisine de Sangatte. En trois ans, 70.000 migrants du monde entier y transitent. Sous la pression de Londres, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, ferme ce centre en décembre 2002. Les exilés se dispersent dans Calais et sa périphérie : ils dorment dans les rues, créent les premiers squats et la première « jungle », un camp sauvage, à proximité de l’entrée du tunnel sous la Manche. En septembre 2009, les forces de l’ordre évacuent ce campement d’environ un millier de personnes.
Mais petit à petit, les migrants reviennent à Calais. En 2015, un lieu d’accueil provisoire est ouvert à l’écart du centre-ville, au milieu d’une lande battue par les vents. Des repas y sont distribués et les migrants s’installent autour du bâtiment : la « new jungle » est née. C’est le premier bidonville à être toléré par les autorités françaises depuis la fermeture du centre de Sangatte. Le nombre de migrants augmente fortement, jusqu’à 10.000 personnes y vivent selon les associations. Les heurts entre forces de l’ordre et exilés, ainsi que les violences entre migrants se multiplient. Un sentiment d’insécurité et l’insalubrité du camp nourrissent la colère des riverains de la « jungle ». Finalement, le bidonville est démantelé en octobre 2016.
Les migrants n’ont pas disparu pour autant. Cet hiver, ils seraient entre 500 et 800 – majoritairement des Soudanais, Érythréens, Afghans ou Iraniens – à errer dans la ville portuaire. Les forces de l’ordre expulsent leurs lieux de vie toutes les 48h. La mairie et la préfecture entendent lutter contre ce qu’elles appellent les « points de fixation ». « C’est une autre façon de dire qu’ils cherchent à décourager les gens de rester ici, près de la frontière », décrypte François Guennoc, président de l’association l’Auberge des migrants. « Ça passe par des expulsions quasiment quotidiennes, par l’édification de murs et de grillages partout où les exilés ont tenté de s’installer, des déboisements de façon à empêcher les gens de se cacher et des pressions policières constantes ». En septembre 2020, au prétexte de la gestion de la pandémie de coronavirus, un arrêté préfectoral a aussi limité la distribution de repas par les associations, créant la polémique.
La préfecture du Pas-de-Calais justifie ces actions par la volonté d’« éviter la reconstitution de campements insalubres qui deviendraient en peu de temps des bidonvilles. Selon les interventions, entre 10 et 50 tentes peuvent être démantelées sur divers lieux d’implantation ». Ces expulsions sont basées sur le principe de la flagrance. Tant que le camp n’a pas une existence de plus de 48 heures, la police peut intervenir sur ordre du procureur de la République pour faire cesser l’occupation du terrain « avec une plainte préalable des propriétaires concernés, publics ou privés », explique la préfecture.
Parfois, des évacuations de plus grande ampleur ont lieu, accompagnées de « mises à l’abri » : des bus sont affrétés pour emmener les migrants qui le souhaitent en centre d’hébergement. Mais pour les associations, il s’agit de « mises à l’abri forcées ». « Les gens ne consentent pas forcément à être emmenés aux quatre coins de la France », affirme Marion Dumontet de la Cabane Juridique.
« On ne leur donne pas d’informations et il y a un dispositif policier important déployé à ce moment-là. Tout est confus, car les expulsions et les mises à l’abri se passent en même temps. Est-ce qu’on consent vraiment à monter dans un bus à ce moment-là ? » interroge la militante.
Le reste du temps, la préfecture rappelle que les exilés peuvent rejoindre un Centre d’Accueil et d’Examen des Situations (CAES), « permettant une mise à l’abri dans des conditions dignes et un examen accéléré des situations administratives ». Le département en compte deux, mais ils sont éloignés de la côte. Beaucoup préfèrent rester à Calais pour continuer à tenter de passer en Angleterre.
Une heure après l’évacuation de leur campement, Malek et quelques autres Afghans sont de retour sur le même terrain vague. Au milieu des détritus qui jonchent le sol boueux, l’un d’entre eux réchauffe de la sauce et des haricots au-dessus d’un petit feu de bois. « On n’est pas fous, on ne viendrait pas vivre ici dans ces conditions si on n’avait pas de problème dans notre pays », dit le jeune homme.
Ils n’ont pas été arrêtés ce matin-là, bien qu’un véhicule de la police aux frontières faisait partie du convoi des forces de l’ordre. « Les contrôles sont arbitraires et aléatoires. Cela contribue à l’angoisse des exilés. Beaucoup essaient de ne pas être présents lors des expulsions, car ils savent qu’ils peuvent être arrêtés », explique Chloé Smidt-Nielsen de HRO. Pour François Gemenne, spécialiste des flux migratoires et chercheur à Sciences-Po Paris, « cela coûte cher d’arrêter les gens, il faut les placer en centre de rétention, il faut qu’il y ait de la place... Le but des évacuations est de donner l’impression que l’État fait quelque chose contre l’immigration, mais l’État ne cherche pas fondamentalement à déplacer ces gens. Il n’y a pas de politique d’immigration pensée ».
« Pour l’État, ce sont des gens de passage qui ne méritent pas qu’on investisse dans leur accueil. C’est ce qui conduit aux campements », poursuit le chercheur. Pour ces migrants, Calais est souvent la dernière étape d’une longue errance à travers l’Europe. « Il n’y a qu’une minorité de gens ici dont c’est un vrai projet d’aller en Angleterre, avance François Guennoc de l’Auberge des migrants. Ceux qui sont là sont en grande majorité des déboutés du droit d’asile, qui viennent d’un peu partout, ou des gens qui ont eu des papiers pour une certaine durée, mais qui n’ont pas été renouvelés ». Il y a aussi « les dublinés », surnommés ainsi, car ils tombent sous le coup du règlement de Dublin. Ce dernier stipule qu’ils doivent faire leur demande d’asile dans le pays d’Europe dans lequel ils sont arrivés. Faute de perspectives dans l’Hexagone, ils espèrent eux aussi rejoindre le Royaume-Uni.
L’Angleterre malgré les dangers et l’inconnue de l’ère post-Brexit
Les côtes britanniques ne sont qu’à 35 kilomètres de Calais et les exilés prennent tous les risques pour les atteindre. Les migrants, qui n’ont pas d’argent pour payer un passeur, tentent de monter à bord des camions qui empruntent le tunnel routier sous la Manche. Les forces de l’ordre interviennent parfois violemment pour les disperser. Arrivé à Calais, deux mois plus tôt, un Soudanais de 25 ans qui souhaite rester anonyme a été blessé au bras début décembre : « J’ai essayé de passer en Angleterre en montant dans un camion, car il y avait beaucoup de bouchons. Mais des policiers sont arrivés et j’ai été arrêté. Ils m’ont tabassé, ils ont jeté du gaz lacrymogène sur moi et à la fin, j’ai été frappé aux mains et au bras ». L’homme, qui a désormais le bras dans le plâtre, a décidé de porter plainte.
L’association la Cabane juridique l’accompagne dans ses démarches, même si les chances d’aboutir à une condamnation sont minces. « Il n’y a presque jamais de condamnation des forces de l’ordre », reconnaît Nora Fellens, juriste chargée des violences policières. « Souvent, c’est parole contre parole et les plaintes sont classées sans suite ».
Face aux difficultés pour passer à bord des camions, les traversées en petits bateaux ont fortement augmenté depuis deux ans. La préfecture maritime a recensé plus de 9.500 passages ou tentatives de passage de la Manche sur des embarcations de fortune en 2020, soit quatre fois plus qu’en 2019. Selon des médias britanniques, plus de 8.000 personnes auraient réussi à rejoindre l’Angleterre de cette façon. Un taux de réussite élevé, mais ces traversées restent très dangereuses : la Manche est l’un des détroits les plus fréquentés au monde. Les courants y sont particulièrement violents. Sept personnes, dont cinq membres d’une même famille, sont ainsi décédées dans le naufrage de leur embarcation le 27 octobre dernier.
Selon François Guennoc, la situation à Calais s’est durcie depuis l’été dernier, « cela coïncide avec l’arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur et avec des gesticulations importantes des autorités britanniques qui protestent contre le fait que la France n’en ferait pas assez pour empêcher les gens de traverser la Manche ». L’explosion des traversées maritimes a été très médiatisée au Royaume-Uni. Le chercheur à l’Institut français des relations internationales (IFRI) Mathieu Tardis confirme : « La France est très soumise à la manière dont cette question est traitée médiatiquement et politiquement de l’autre côté de la Manche ». Depuis les accords du Touquet de 2003, la frontière britannique se trouve sur les côtes françaises. Moyennant finance, la France contrôle l’immigration clandestine vers l’Angleterre. Le 28 novembre 2020, les deux pays ont annoncé un nouvel accord pour renforcer la surveillance de la Manche : doublement des patrouilles françaises sur les plages du nord appuyées de drones et de radars. En échange, le Royaume-Uni s’est engagé à investir 31,4 millions d’euros pour soutenir les efforts français.
Les Britanniques privilégient ainsi l’approche sécuritaire pour limiter les arrivées sur leur territoire. Depuis leur sortie de l’Union européenne le 1er janvier 2021, ils ne peuvent plus s’appuyer sur le règlement européen de Dublin pour renvoyer les exilés vers d’autres pays européens.
Aucun autre texte ne remplace ce vide pour l’instant, car les politiques d’asile et d’immigration ont été laissées en-dehors du mandat de négociation de l’accord sur le Brexit. La sortie du règlement de Dublin signifie aussi la fin d’une des rares voies légales d’accès au Royaume-Uni : celle du regroupement familial. « En n’anticipant pas l’impact du Brexit sur les politiques migratoires, les dirigeants européens ont laissé le gouvernement britannique refermer un peu plus ses frontières sans en assumer les conséquences », s’alarment plusieurs associations dans une tribune publiée dans le journal Libération.
Ces dernières craignent que le Royaume-Uni durcisse encore sa législation en matière d’asile. « Les Britanniques sont toujours dans le Conseil de l’Europe et dans la Convention européenne des droits de l’Homme, donc ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent », souligne le chercheur Mathieu Tardis. « Je pense qu’un des enjeux pour eux sera de voir à quel point ils veulent s’éloigner des standards européens ou non ». Le sort de tous ceux bloqués à Calais dans l’espoir de rejoindre le Royaume-Uni est l’une des grandes inconnues de l’ère post-Brexit.