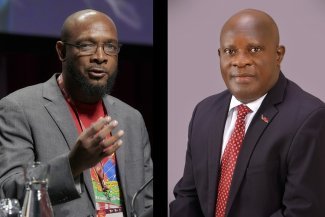Tonny Azzi, agent de police municipal, organise son trousseau de coiffeur chez lui à Dbayeh, dans le sud du Liban.
Il y a 22 ans, Tonny Azzi troquait ses ustensiles de coiffeur contre un badge et un pistolet. Travailler dans la fonction publique allait lui assurer stabilité financière, sécurité sociale et pension de retraite. Aujourd’hui, pour joindre les deux bouts, l’agent Azzi a dû reprendre son activité de coiffeur, à son domicile, à Dbayeh, commune proche des monts du Chouf.
« Ma femme aussi travaille, elle est enseignante, mais avec ce que nous touchons, nous n’arrivons pas à subvenir aux besoins de base de la famille », déplore-t-il. Son salaire de fonctionnaire s’élève à 2.000.000 de livres libanaises, ce qui avant la crise financière représentait environ 1.210 euros. Au taux de change actuel, il ne représente guère plus que 126 euros.
Une telle précarité est devenue une réalité courante parmi les fonctionnaires qui, pour survivre au Liban aujourd’hui, sont obligés de cumuler plusieurs emplois, en plus de leur travail au sein de la fonction publique.
Dbayeh, troisième plus grande commune du Liban, compte quelque 20.000 habitants, mais la sécurité n’y est assurée que par Azzi et son partenaire Nassir. Tous deux ont atteint l’âge de la retraite et sont employés à durée indéterminée. Le reste de l’équipe est composée d’une dizaine d’agents locaux, tous sous contrats temporaires.
« À nous deux, nous effectuons tous les contrôles, dont nous faisons rapport à la municipalité. Nous sommes donc chargés de toutes les constructions illégales, des appartements habités non enregistrés et des raccordements illégaux aux réseaux d’eau et d’électricité pour tout le territoire. On est débordé de travail et le peu que je gagne, je dois directement le débourser pour le groupe électrogène », se plaint M. Azzi.
Les employés de la mairie de Dbayeh, dont dépendent les villages alentour, sont eux aussi fréquemment surmenés. Suite aux coupes budgétaires opérées par le gouvernement pour renflouer les caisses publiques en faillite et l’entrée en vigueur, en 2019, d’une réglementation qui n’autorise pas le recrutement de nouveaux fonctionnaires au Liban, les administrations locales se retrouvent à court d’effectifs. Ainsi, Dolly Boustany, doyenne du conseil municipal de Dbayeh, se retrouve en plus de ses fonctions normales, à devoir s’occuper des tâches administratives – la secrétaire ayant pris sa retraite il y a deux ans – mais aussi à assurer la fonction d’adjointe au maire lorsque celui-ci doit s’absenter.
Avec la dépréciation de la monnaie et l’inflation, les fonctionnaires municipaux sont parfois amenés à devoir se demander s’il vaut bien la peine de se rendre au travail, dans la mesure où les seuls frais de carburant peuvent dépasser leur salaire à la fin du mois.
« Nous demandons une augmentation des aides au transport. Ils nous accordent 25.000 livres libanaises de plus par semaine pour le transport », ce qui équivaut à un dollar et demi (1,6 euros) – les cours ne cessent de dégringoler –, explique le fonctionnaire de la mairie. Si bien que l’absentéisme au sein de la fonction publique est un secret de polichinelle. « Ils se présentent au poste de police ou à l’académie à raison d’une ou deux fois par semaine », explique un officier de police sous couvert d’anonymat.
« Les officiers ferment généralement les yeux sur les agents moins gradés, considérant qu’il serait immoral de les obliger à se présenter au poste alors qu’ils gagnent leur vie ailleurs », reconnaît la source policière. « Nous avons été contraints au végétarianisme », plaisante-t-il pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais le fait est qu’avec une inflation proche de 200 %, le prix de la viande est devenu prohibitif.
« Dans pareilles conditions, qui peut encore blâmer l’administration publique pour être profondément corrompue ? », s’exclame Mme Boustany, résignée, faisant allusion à un autre des fléaux enracinés dans la crise.
Des idées pour unifier et éviter l’effondrement
La crainte d’un effondrement de la police et d’une désertion des effectifs a poussé l’autorité militaire à « saisir les passeports » des membres des forces de sécurité afin de les empêcher de fuir le pays, admet un diplomate européen qui souhaite garder l’anonymat.
« Du fait de l’effondrement financier, il n’y a plus d’État. À partir du moment où une institution cesse de se préoccuper ou abdique ses responsabilités, des administrations parallèles voient le jour. C’est la situation que l’on observe au niveau municipal. Il n’y a pas de relation entre le ministère de l’Intérieur et les communes », explique Thomas Valetas, membre de l’équipe du projet européen pour une « Police de proximité ». Il s’agit d’un projet à financement européen, doté d’un budget de 15 millions d’euros et couvrant une période de cinq ans, à compter de 2021. Sa mise en œuvre est assurée conjointement par l’agence espagnole FIIAPP et l’agence française CIVIPOL.
L’un des défis de ce programme, selon M. Valetas – qui supervise les cours de formation de la police locale à l’Académie des forces de sécurité intérieure (ISF) – consistera à « unifier la police locale en termes de responsabilités et de tâches » afin d’abolir cette sorte de système moderne de taifas, où chacun fait ce qui lui plaît dans sa chasse gardée.
Selon M. Valetas, les membres de la police locale sont choisis en raison de leur loyauté envers le maire et, malheureusement, la plupart d’entre eux « n’ont aucune éducation ou formation ».
Des années de clientélisme et de corruption au sein de la fonction publique ont nourri la méfiance des citoyens à l’égard des forces de sécurité, si bien que changer les perceptions de la population relève désormais de la gageure.
« En tant que fonctionnaires publics, les agents doivent être au service des citoyens », insiste M. Valetas. « Notre objectif est de centraliser les forces de sécurité et de mettre en place une coopération entre les acteurs nationaux, municipaux et la société civile, or ces derniers rechignent à changer d’approche les uns envers les autres », déplore-t-il.
« Pour assurer la durabilité de ce projet – une fois que nous aurons terminé notre formation – nous devrons veiller à ce que la police municipale puisse continuer à recevoir la même formation que celle que nous lui avons dispensée par l’intermédiaire de formateurs locaux », souligne-t-il.
Initiatives privées : pour la sécurité des citoyens ou pour certaines minorités en particulier ?
La vulnérabilité des forces de sécurité est une bombe à retardement pour le Liban, un pays aux abois, gangréné par les troubles et la délinquance, parallèlement à la crise économique et financière. Selon des données publiées par l’agence International Information, basée à Beyrouth, les délits de vol ont augmenté de 266 % depuis la période précédant la crise économique.
Les Libanais ne se sentent pas en sécurité ni protégés dans leur quartier. On voit ainsi des habitants recourir aux clans familiaux ou aux partis politiques, comme une façon de prendre en main leur propre protection. Dans certains quartiers, des partis ont, de fait, assumé le rôle de prestataires privés de services de sécurité, en échange d’un soutien politique ou d’argent.
Si ces dispositifs de sécurité informels sont surtout répandus dans les zones chiites sous le contrôle du parti Hezbollah et de son partenaire, la milice Amal, des hommes politiques chrétiens, tels que le député Nadim Gemayel des Phalanges libanaises, ont également commencé à former et à financer leurs propres « vigiles » dans le quartier chrétien d’Achrafieh, dans le centre de Beyrouth. La morosité ambiante due au manque d’éclairage public dans le centre de Beyrouth et la montée de la criminalité ont incité le chef des Phalanges à faire appel à une société de sécurité privée pour former deux cents volontaires, qui patrouillent dans les rues, armés de torches et de bâtons. « Il s’agit là d’un droit fondamental, que nos voisins, nos enfants, se sentent en sécurité quand ils sortent ou rentrent chez eux. Nous sommes ici pour protéger nos familles », s’exclame Akram Nehme, qui supervise cette initiative.
Pour certains résidents d’Achrafieh comme Mariam, ces « anges gardiens » ont contribué à ramener un semblant de sérénité aux familles du quartier. « Je fermais généralement mon magasin à sept heures et demie du soir. Mais à présent, je ferme plus tôt car les clients ne viennent plus, la rue n’étant pas éclairée. Il n’y a plus personne à cette heure, et ce n’est vraiment pas très rassurant. Depuis que les vigiles sont là, je me sens un peu plus en sécurité », confie Mariam, propriétaire d’un petit commerce local.
Alors que les habitants de ce quartier chrétien saluent l’initiative, d’autres la critiquent, la comparant à l’époque de la guerre civile libanaise (1975-1990), lorsque des milices patrouillaient dans les rues de leurs quartiers respectifs.
Dans un pays comme le Liban où les barrières confessionnelles (invisibles) divisent la population, le fait qu’un groupe de vigiles de nuit prenne en charge la sécurité n’a pas manqué de déclencher des sonnettes d’alarme. « Notre pays vit une période particulièrement délicate. Nous sommes sans président et sans gouvernement. Tout le monde appelle au démantèlement et au désarmement du Hezbollah. Nous ne pouvons pas laisser à présent un autre groupe prendre en charge la sécurité de son territoire », prévient Michel Chadarevian, qui fut conseiller diplomatique de l’ancien président libanais Michel Aoun.
Nadim Gemayel réfute néanmoins les critiques selon lesquelles son initiative présente des similitudes avec les patrouilles organisées par les milices lors du conflit confessionnel libanais. « Nous ne sommes pas en guerre civile. Nous ne sommes pas en situation de guerre. Nous ne cherchons pas à remplacer les forces de sécurité, et nous travaillons en coordination étroite avec la police, les services de renseignement et les autres autorités compétentes », souligne le chef du parti chrétien Phalanges libanaises.
Il est pourtant difficile de faire abstraction du passé, d’autant que le patronyme « Gemayel » évoque, pour bien des Libanais, le temps de la guerre civile. Bachir Gemayel, le père de Nadim, a été le premier président chrétien à avoir été assassiné pendant la guerre fratricide des années 1980. C’est aussi Bachir Gemayel qui a fondé les Forces libanaises, une milice chrétienne sanguinaire, accusée du massacre de milliers de réfugiés musulmans et palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila en 1982.