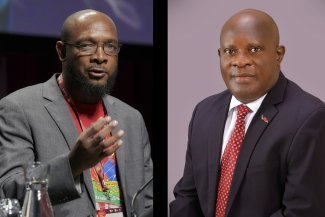Nous vivons dans un monde où la production d’aliments est excédentaire mais « le problème, c’est que la production nourrit un modèle commercial qui réussit très bien à vendre des produits comestibles, mais très mal à alimenter les personnes ».
En 2016, Marcos Filardi a entrepris un voyage initiatique : pendant un an, il a parcouru 260 communes tout au long du territoire argentin en dressant la carte des différentes initiatives liées à la souveraineté alimentaire dans l’ensemble du pays. « Après ce voyage, j’ai tout d’abord réalisé que j’avais trouvé bien plus que ce que j’avais pu imaginer ; et si je repartais aujourd’hui, je découvrirais bien d’autres expériences », affirme cet avocat spécialisé en droits humains et souveraineté alimentaire.
L’Argentine est sans doute l’un des pays du monde où le modèle de l’agro-industrie s’est le plus solidement implanté : 60 % des terres cultivables sont monopolisées par le soja transgénique, ce fameux soja inventé par la multinationale Monsanto et résistant aux produits agrochimiques contenant du glyphosate.
Peut-être même à cause de cette conjecture, l’Argentine est devenue un laboratoire où les résistances se multiplient. « Certaines agissent “face au monstre”, telles les communautés qui luttent contre les fumigations, ou tentent de freiner l’expansion des frontières de l’agro-industrie ; d’autres se placent “dos au monstre”, en expérimentant ou en récupérant ce qui existait auparavant », dit M. Filardi. Il emprunte cette métaphore à Jonathan Nossitter, réalisateur fasciné par la viticulture « naturelle » et auteur du livre Insurrection culturelle. Dans son ouvrage, celui-ci remet en question, entre autres, notre résignation à considérer comme « normale » l’utilisation des pesticides alors que ce « modèle “toxico-dépendant” détruit les sols et la diversité et rend en outre les corps malades », affirme Marcos Filardi.
Parmi les expériences relevées par cet avocat au cours de son voyage, se trouvent les projets visant à mettre en place une production agricole biologique extensive et revendiquant l’idée que l’agriculture biologique ne doit pas se contenter d’un petit potager dans l’arrière-cour des maisons ou des écoles, mais qu’elle peut également se développer sur de vastes superficies. Une initiative pionnière a été mise en place à Guaminí, où plusieurs producteurs se sont regroupés afin de produire du blé biologique. La municipalité a mis à leur disposition un moulin financé par des fonds publics et les producteurs ont réussi à vendre de la farine bio au-dessous du prix du marché. Ils s’attaquent de la sorte à un mythe bien ancré, qui veut que les aliments biologiques doivent être plus chers, et que seuls les nantis puissent avoir accès à des aliments sains.
Plusieurs formes de commercialisation alternatives au modèle dominant des supermarchés et grandes surfaces ont vu le jour, dont des coopératives de consommateurs, des marchés directs où le producteur va au-devant des « convives » – terme que ces « résistances » préfèrent à « consommateur » –, ou même des semailles engagées, où un groupe de convives urbains planifie les cultures conjointement avec les producteurs.
« Les marchés représentent bien plus qu’un lieu de rencontre entre l’offre et la demande ; c’est toute une chaîne de significations qui se tisse là et lorsque le convive s’empare d’une houe et qu’il sent une douleur à la taille après une journée de travail aux champs, je t’assure qu’il ne va pas marchander le prix », assure M. Filardi.
Dans les grandes villes, une des modalités de commercialisation – destinées à éliminer les intermédiaires – avec le plus de succès au cours des dernières années, est la vente directe de sacs de fruits et légumes. Le MTE Rural, branche du MTE, le Mouvement des travailleurs exclus, a ainsi mis en place l’initiative Pueblo a Pueblo [pueblo signifiant à la fois village et peuple], qui « se fonde sur la nécessité de contourner la longue chaîne d’intermédiaires du marché conventionnel, qui payent parfois les familles de producteurs à un prix inférieur aux coûts de production », explique Pablo Aristide, l’un des organisateurs. « Les producteurs préparent des sacs d’environ cinq kilos qu’ils amènent dans différents points de la ville pour être collectés le jour convenu. Les familles de producteurs ont donc dû se regrouper et s’organiser afin de prendre des décisions sur le prix et le contenu des sacs, ce qui a supposé des changements intéressants, notamment l’adoption d’une manière de travailler plus collective », ajoute-t-il.
Les expériences « dos au monstre » cohabitent avec les pratiques de résistance qui s’opposent de front au modèle dominant. La cartographie élaborée par Marcos Filardi au cours de son voyage a surtout permis de tisser des réseaux entre ces différents acteurs, dont un grand nombre participe aux Chaires libres sur la souveraineté alimentaire qui se multiplient dans l’ensemble du territoire national. Le Réseau des avocates et avocats pour la souveraineté alimentaire (REDASA) les a rejoints depuis novembre dernier. REDASA a été fondé à Buenos Aires avec des participants de l’Uruguay, du Brésil, de la Bolivie, du Honduras et de l’Argentine, et se donne pour objectif de réunir les juristes travaillant sur les questions de souveraineté alimentaire sous différents angles, qu’il s’agisse de contentieux, de recherche ou de conseil en matière législative. Ils souhaitent maintenant nouer des réseaux similaires en Asie et en Afrique, parce que même si les solutions doivent être envisagées sur le terrain, les problèmes auxquels chacun se heurte sont mondiaux.
La faim comme argument de légitimation
Depuis la Révolution verte, avec la généralisation, entre les années 50 et 60 du siècle dernier, des pesticides et herbicides afin d’augmenter le rendement des récoltes, le principal argument de légitimation du modèle agricole était celui d’en finir avec la faim. Dès les années 80 ce modèle s’est structuré en tant qu’agro-industrie ou agribusiness, avec un rôle croissant des finances et une mainmise grandissante des grandes entreprises sur le secteur agricole. L’idée sous-tendue par cette économie agro-industrielle est qu’il serait utopique de penser que la population des grandes villes puisse se nourrir sur la base d’initiatives comme celles que M. Filardi a rencontrées au cours de son voyage.
« Le système agroalimentaire est contrôlé par une poignée de corporations au niveau mondial : cinq industries céréalières qui monopolisent la commercialisation des céréales, quatre entreprises chimiques qui détiennent le marché des pesticides, engrais et semis, huit à dix corporations dans l’industrie alimentaire, cinq géants de la distribution et sept compagnies pétrolières », résume Marcos Filardi. Cela n’a donc jamais été un problème de production mais de distribution et d’accès aux aliments ; autrement dit, il ne s’agit pas d’une question technique, mais au contraire politique. Le gaspillage alimentaire en est la preuve : selon la FAO, chaque année 1,3 milliard de tonnes d’aliments finissent dans la poubelle, soit un tiers de la production totale. De plus, les surfaces consacrées à la monoculture sont, pour une large part, destinées à des usages qui ne concernent pas l’alimentation humaine, comme la fabrication de biocarburants.
Pour la journaliste argentine Soledad Barruti, auteure du livre Mala leche. El supermercado como emboscada (Planeta, 2018) [Le lait tourne. Les embuscades des supermarchés – non traduit en français], « l’utopie, c’est de penser que ce système agro-industriel puisse avoir un avenir. Nous vivons dans un monde qui produit tout en surabondance, les aliments inclus. Le problème, c’est que la production nourrit un modèle commercial qui réussit très bien à vendre des produits comestibles mais très mal à alimenter les personnes. Ce modèle a besoin d’ingrédients bon marché pour fabriquer des aliments ultra-transformés et maquillés d’une couche de fausse diversité qui n’appartient en propre ni à l’agriculture, ni aux rayons de supermarché, ni aux tablées familiales ». Elle ajoute que « cette supercherie éclate sur les corps sous forme de maladies et ravage les terres d’Amérique Latine, véritable paradis de diversité génétique ».
On pourrait par ailleurs se demander s’il est possible de faire coexister le modèle agro-industriel et biologique. Marcos Filardi répond par la négative : « Non, un modèle dévore l’autre. Tout d’abord parce que l’agro-industrie repousse sans cesse ses frontières, ce qui entraîne des conflits, mais aussi parce ce qu’en réalité, elle rend l’agriculture biologique non viable : si mon voisin sème du maïs transgénique, il contamine tout ». L’eau et le vent ignorent les frontières.
Les champs de La Aurora en sont l’exemple paradigmatique : 670 hectares sont consacrés aux cultures biologiques au sud de la province de Buenos Aires et, depuis 27 ans, aucun pesticide n’y est utilisé. Les analyses effectuées décèlent pourtant traces de glyphosate et d’autres pesticides qui, comme l’explique M. Filardi, sont « transportés par les eaux de pluie, par infiltration ou ruissellement ». L’eau de pluie est en effet devenue toxique : l’an dernier, des chercheurs du Conseil national de recherche scientifique et technique (Conicet) ont démontré la présence de glyphosate ainsi que d’autres substances toxiques dans les échantillons d’eau de pluie prélevés dans les provinces de Santa Fe, Córdoba et Buenos Aires.
L’abandon de l’agro-industrie ne peut être individuel. « L’alimentation est un phénomène collectif : des actions peuvent être envisagées individuellement, mais elles n’auront qu’un impact réduit. Cela devient évident lorsqu’on a des enfants : si l’on ne veut pas qu’ils mangent des produits ultra-transformés, il faut user de beaucoup de persuasion, et même ainsi, se sont eux qui vont en faire les frais et devenir des phénomènes. De plus, ce modèle a des retombées qui nous affectent même si on n’y prend pas part : la résistance aux antibiotiques engendrée par les abus de l’élevage industriel est une menace qui nous atteint tous, que l’on mange ou non du poulet ou du bœuf », déclare l’auteure Soledad Barruti.
« L’Argentine est le deuxième exportateur mondial de produits biologiques, [qu’il s’agisse de fruits et légumes ou de produits à base de viande – avec une production animale qui se concentre en Patagonie]. Toutes ces exportations se font au détriment de la qualité de notre alimentation, [autrement dit,] les bovins biologiques sont consommés par autres », affirme Marcos Filardi. L’avocat spécialisé en droits humains et souveraineté alimentaire se réfère là aux mots par lesquels l’auteur-compositeur-interprète Atahualpa Yupanqui a synthétisé en deux vers implacables la colonisation exercée par le pouvoir économique : « Nous avons les chagrins / d’autres ont les bovins ».