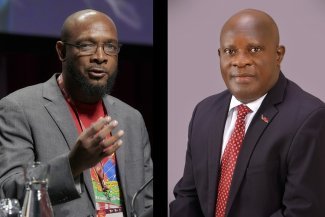Les Brésiliens qui ont décidé de descendre dans la rue en défense de la démocratie ont pu constater de première main le durcissement de la répression policière.
En 2010, la chaîne argentine Encuentro a diffusé une série d’interviews de présidents latino-américains qui resteront gravées pour la postérité : Le Brésilien Lula da Silva, le Vénézuélien Hugo Chávez, l’Équatorien Rafael Correa, l’Argentine Cristina Fernández de Kirchner, la Chilienne Michelle Bachelet, l’Uruguayen Pepe Mujica et le Paraguayen Fernando Lugo.
Tous ces chefs d’État, aussi divers fussent-ils, avaient une chose en commun : Ils faisaient partie des ces gouvernements qui s’autoproclamaient progressistes et qui ont maintenu leur prédominance sur le continent durant les quinze premières années de ce siècle, même si l’hégémonie de la droite s’est maintenue dans certains pays comme la Colombie et le Mexique.
Fini le temps de la splendeur des progressismes ; le néolibéralisme fait son retour au pouvoir, que ce soit par la voie des urnes, comme dans le cas de l’Argentine en 2015, ou en l’absence de celles-ci, comme au Brésil ; dans d’autres pays, comme l’Équateur, le Venezuela et la Bolivie, les progressismes se maintiennent mais se voient de plus en plus affaiblis, et ce au milieu de contradictions internes. Une chose semble incontestable : Un moment de transition politique est en train de se vivre à travers le continent.
Les progressismes, à défaut d’un appellatif plus consensuel qui reflète mieux des mouvements politiques aussi divers que le lulisme, le chavisme ou le kirchnerisme, ont surgi en réaction aux politiques néolibérales des années 1990 (qui ont réduit les dépenses sociales, démantelé le tissu industriel et privatisé les entreprises publiques).
La mobilisation populaire, où les indigénismes ont occupé une proéminence croissante, a ouvert la voie à ces gouvernements : Comme la fameuse guerre de l’eau de Cochabamba, en Bolivie, ou le slogan « qu’’ils s’en aillent tous » proféré par les Argentins après la crise funeste de 2001.
Les gouvernements progressistes ont restauré la prééminence de l’État et ont brandi pour fer de lance des projets nationaux qui avaient pour vocation de s’affranchir du joug impérialiste des États-Unis, misant à la place sur l’intégration régionale, en donnant une impulsion résolue au Mercosur et à de nouvelles initiatives comme Unasur ou Banco del Sur.
Il n’y a pas eu que des ruptures mais aussi des continuités que la sociologue argentine Maristella Svampa résume dans ses travaux de recherche sous l’expression « consensus des commodities ». Elle se réfère à comment, à un moment où les prix des matières premières (commodities) plafonnaient, tous les pays d’Amérique latine – tant les droites – regroupées au sein de l’Alliance du Pacifique - que les progressismes, ont opté pour une reprimarisation de leurs économies, fortement tributaires de l’exportation de matières premières.
Et c’est ce qui a fini par aliéner les mouvements indigènes ou paysans, qui ont été les principaux affectés par les répercussions socio-environnementales des méga-chantiers miniers à ciel ouvert, de la monoculture de soja et de palmiers à huile, de l’exploitation pétrolière et de la construction de grands barrages, entre autres.
Maristella Svampa parle d’une tension croissante entre deux visions diamétralement opposées : « L’une, indianiste, éco-territoriale et décolonisatrice, axée sur le respect de la nature ; l’autre, nationale-populaire, marquée par une dimension étatique et centralisatrice ».
L’exemple de l’Équateur illustre ce conflit et se résout en faveur de la seconde option. D’où les critiques émanant de la gauche : « La criminalisation de la contestation sociale est devenue pratique courante sous le corréïsme. Correa est la droite du XXIe siècle : Il a modernisé l’État pour moderniser le capitalisme », conclut l’économiste équatorien Alberto Acosta.
Magdalena León, elle aussi économiste et équatorienne, conteste : « Il s’agit d’une erreur stratégique de la gauche de se quereller avec son allié, l’Équateur ».
La nouvelle Classe C
À la différence de l’extractivisme des élites, les gouvernements progressistes –dénommés « néoextractivistes » par l’Uruguayen Eduardo Gudynas – ont utilisé une partie des revenus des exportations pour financer des politiques sociales qui ont permis des progrès incontestables dans la lutte contre la pauvreté et la misère.
Rien qu’au Brésil, 30 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et ont grossi les rangs de la nouvelle classe moyenne ou Classe C. Lula et sa successeur, Dilma Rousseff, y sont parvenus à coups de programmes d’aide comme la Bolsa Familia, mais aussi grâce à des mesures comme l’augmentation des pensions en milieu rural et l’augmentation soutenue du salaire minimum qui, en l’espace d’une décennie, a augmenté de 70%, hors inflation.
Le problème est que le cycle haussier des matières premières a touché à sa fin et a été suivi d’une crise économique généralisée qui a frappé de plein fouet le Brésil et tout le reste de la région.
C’est à ce moment, comme le signale l’activiste et chercheur Guilherme Boulos à Equal Times, membre du Mouvement des travailleurs sans terre (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST), que Rousseff a dû faire un choix :
« Tant qu’ils étaient accompagnés du cycle économique, les gouvernements de Lula et Dilma ont réussi à améliorer le sort des couches les plus défavorisées de la société sans toucher aux intérêts des oligarchies ; cependant, le moment est arrivé de se définir une fois que le contexte économique s’est détérioré. »
Le Parti des travailleurs (PT) de Lula et Dilma a opté pour la « modération », s’attirant par-là même les critiques des mouvements de base, mais cela n’a pas suffi à calmer une opposition politique et médiatique qui a fini par expulser Rousseff de la présidence dans ce que le politologue brésilien Renato Martins a décrit comme une « interruption du régime démocratique ».
Nonobstant, les élections municipales ont dans beaucoup d’endroits du pays réaffirmé par la voie des urnes levirage à droite, avec des résultats aussi tranchants que la victoire du pasteur évangélique Marcelo Crivelle à Rio de Janeiro.
Corruption et manipulation
Au Brésil, ce fut la corruption et, en particulier, le scandale de l’affaire Lava Jato qui a frappé de plein fouet la principale entreprise d’État du Brésil, la compagnie pétrolière Petrobras, qui a servi d’argument pour la destitution de Dilma Rousseff, deux ans après que les électeurs lui ont concédé son second mandat.
Le fait que la corruption au Brésil fût endémique et généralisée semblait importer peu, et si elle entachait le PT, elle impliquait encore plus directement les partis de l’opposition PSDB et PMDB. « Eduardo Cunha, qui a joué un rôle clé dans la procédure de destitution ou impeachment, est un corrompu avéré qui possède des comptes en Suisse et demeure en liberté, pendant que d’autres sont incarcérés en l’absence de preuves concluantes », signale Martins.
L’opération Lava Jato pointait du doigt le système politique tout entier mais c’est Rousseff qui est tombée.
Martins appelle cela la « justice sélective » et met en cause la complicité des médias qui crient sur tous les toits les abus du PT mais passent sous silence ou minimisent ceux des autres. Quelque chose de similaire est en train de se produire en Argentine, où les médias hégémoniques, avec à leur tête le groupe Clarin, réservent leurs manchettes aux cas de corruption impliquant le kirchnerisme mais passent sous silence les comptes panaméens associés à Mauricio Macri.
La « justice sélective », selon Martins, a permis à l’ex-vice-président de Dilma, Michel Temer, d’assumer la présidence sans aucune légitimité et d’imposer dans l’urgence des mesures destinées à démanteler les politiques de redistribution des revenus. Le cas le plus flagrant est celui du projet de loi PEC 241 qui, s’il est ratifié au Sénat, permettrait d’inscrire dans la Constitution des restrictions aux dépenses sociales et limiterait, entre autres, les augmentations du salaire minimum aux ajustements de l’inflation.
Dans la pratique, signale Martins, « cela a pour effet de supprimer la fonction-clé de révision du budget » au Congrès. Les Brésiliens qui ont décidé de descendre dans la rue en défense de la démocratie ont pu constater de première main le durcissement de la répression policière.
Dérive « populiste »
Il y a eu d’autres erreurs internes qui ont précipité le déclin du cycle progressiste. S’il y a eu des avancées au niveau des indicateurs sociaux, le modèle suivi a été celui de l’ « inclusion par la consommation » et non l’approche consistant à étendre les droits.
Du reste, le pluralisme s’est très souvent avéré être plus rhétorique que réel : Les « populismes » de gauche ont évolué « vers des modèles de domination plus traditionnels » qui ont eu tendance à « réduire les espaces de pluralisme et à légitimer la concentration du pouvoir politique autour de la figure présidentielle », pour reprendre les propos de Maristela Svampa.
Un autre problème a été le personnalisme excessif de beaucoup de ces propositions politiques, qui entrent en crise lorsqu’elles perdent leur leader : Nicolás Maduro n’est pas parvenu à occuper l’espace laissé par Chávez. De même, Cristina Fernández a quitté la présidence avec un indice élevé de popularité, toutefois sans avoir préparé un candidat à même de remporter les élections.
En Argentine, l’arrivée de Macri a servi de rappel des différences qui existent entre les progressismes et une droite néolibérale, quand bien même cette dernière se pare d’un discours que le sociologue Gabriel Vommaro qualifie d’ « ONG-iste et new age ».
L’une des premières mesures introduites par le macrisme a été de supprimer les impôts sur les entreprises minières et de diminuer ceux appliqués aux exploitants de soja ; parallèlement à cela, les tarifs de l’eau, de l’électricité et du gaz pour la population ont augmenté de jusqu’à 700%. Une autre redistribution des revenus se prépare et menace de réduire à néant les acquis de quinze années de gouvernement de centre-gauche.
Martins prévoit pour le Brésil un avenir sombre : « On amorce un retour vers une barbarie sociale qui a caractérisé le Brésil historiquement. »
La question est de savoir jusqu’à quel point les droites pourront inverser les changements sociaux que laissent derrière eux 15 années de gouvernements progressistes et la réponse, elle, se trouve assurément dans la pression que la société civile parviendra à maintenir dans la rue.