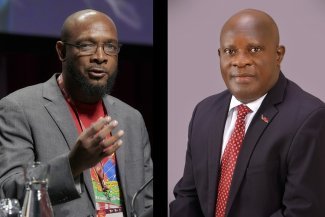Les experts en aide au développement insistent sur l’importance d’une aide déliée pour améliorer l’efficacité des projets d’aide au développement, favoriser le transfert du savoir et promouvoir l’entrepreneuriat à l’échelon local. Dans la photo (2013), un paysan à vélo sur ses terres à Ouelessebougou (Mali).
Aider les pays en développement à sortir de la pauvreté peut se convertir en une opportunité en or pour les intérêts économiques et commerciaux des pays riches.
Les institutions de financement du développement (IFD) publiques ou semi-publiques sont chargées de canaliser vers le secteur privé une partie de l’aide publique au développement destinée à assister les pays moins favorisés. Cependant, les bénéfices de ces initiatives publiques-privées dans les pays en développement ne semblent pas aussi clairs.
L’idée selon laquelle le secteur privé devrait participer aux projets de développement pour faciliter la consolidation du système économique des pays pauvres est répandue et enracinée dans les pays dits riches, et pour preuve, selon l’EDFI (association européenne qui englobe jusqu’à 15 IFD), le portefeuille global d’investissements engagés par ses membres a triplé au cours des dix dernières années, pour atteindre 36.300 millions d’euros (soit environ 40.700 millions de dollars US) à la fin de 2015.
Toujours est-il que le financement public de projets relevant du secteur privé intervient dans un espace flou, situé aux confins de l’aide au développement (facilitant des investissements qui autrement n’iraient pas aux pays émergents) et de l’expansion économique des pays donateurs qui, très souvent, en profitent pour favoriser leurs entreprises.
Le rapport intitulé L’efficacité de développement du soutien au secteur privé par le biais des fonds APD publié en juin par le Réseau syndical de coopération au développement (RSCD-CSI) et l’Alliance des organisations de la société civile pour l’efficacité du développement (AOED) illustre, force exemples à l’appui, l’inefficacité des projets d’investissement s’appuyant sur des partenariats public-privé dans différentes parties du monde.
L’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID) a injecté une quantité considérable de fonds dans une entreprise de gestion des eaux à Cartagena (Colombie), avec la participation d’une société espagnole, et ce malgré le fait qu’en raison des prix exorbitants, chaque mois, des milliers de personnes perdent leur accès à l’eau parce ce qu’elles ne peuvent plus payer les factures. Au Pérou, l’acheminement de l’aide canadienne destinée à améliorer les secteurs agricole et forestier se fait par le biais d’une ONG du pays donateur dont il s’avère qu’elle est, elle-même, financée par plusieurs géants miniers, entre autres. En dépit de son objectif initial, une grosse partie des efforts de l’ONG se bornent, en réalité, à améliorer l’image de l’industrie extractive. Voilà seulement deux des exemples passés en revue dans le rapport.
Au terme de l’examen de neuf institutions de financement du développement (américaines et européennes), les chercheurs sont arrivés à la conclusion que la majorité des IFD ont essentiellement pour mission de favoriser et impulser l’économie de leur pays, de même que les entreprises ayant des investissements dans des pays émergents, sans que les besoins de ces pays n’aient une quelconque pertinence. L’OPIC, aux États-Unis, va même jusqu’à spécifier que son activité a pour objectif de « promouvoir les priorités américaines en matière de politique extérieure et de sécurité nationale ».
L’IFD belge BIO, quant à elle, relève simplement pour mission celle de soutenir un secteur privé fort dans les pays en développement et/ou émergents. « Il n’y a pas de lien direct aux entreprises ou à l’économie belges », explique dans un entretien avec Equal Times Tom De Latte, porte-parole de BIO. « Nous restons bien entendu toujours ouverts aux investisseurs privés, belges ou autres, qui puissent nous aider à accomplir notre mission mais ne sommes certainement pas liés à eux », ajoute-t-il. Une telle position ne constitue, toutefois, pas la norme chez les IFD.
« Ce type d’institutions ne peut et ne doit être considéré comme relevant de l’Aide publique au développement (APD) ou de la coopération internationale au développement », explique Sebastián Ortiz, chercheur auprès de l’Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de l’Universidad Complutense de Madrid. Et d’ajouter : « Il va sans dire que dans la configuration actuelle, ce qui prime c’est uniquement l’intérêt du pays « donateur », qui octroie les crédits et, a fortiori, celui des sociétés qui veulent investir dans le marché du « pays récepteur ou bénéficiaire » ».
Au cours des 15 dernières années, l’OCDE (organisation composée de 35 pays dont provient la majeure partie de l’aide) est arrivée au consensus qu’il ne peut être question d’aide publique au développement que lorsque celle-ci est déliée, autrement dit, quand « elle est administrée en ayant pour principal objectif de promouvoir le développement et le bien-être économiques des pays en développement » ; outre le fait qu’il doit s’agir d’une aide à « caractère concessionnel qui doit comporter une dimension de don ».
Un processus de sélection qui favorise les intérêts propres
Le rapport coédité par le RSCD-CSI et l’AOED signale qu’en dehors des mandats spécifiques des institutions, certains critères établis par les IFD relatifs à l’accès aux financements tendent aussi à faciliter la prépondérance des entreprises des pays développés. Certains critères économiques imposés par les IFD relatifs à la rentabilité, au rendement des investissements et la trajectoire de l’entreprise privilégient l’octroi des aides à des entreprises de pays riches ou à des multinationales plutôt qu’à des petites et moyennes entreprises des pays en développement, qui disposent généralement de structures et de capacités plus faibles mais ont, en revanche, une incidence plus forte sur le développement du pays récepteur.
Le fait de favoriser les entreprises des pays donateurs peut agir au détriment des besoins des pays récepteurs de l’aide, a fortiori quand aucune des institutions examinées dans le rapport n’a l’obligation d’inclure la participation du gouvernement ou d’acteurs sociaux du pays récepteur de l’aide dans aucune des phases du projet financé.
Les critères purement économiques et de rendement ont un autre effet corollaire, à savoir la préférence pour des pays à revenus supérieurs et, par-là, un risque réduit pour les investisseurs. D’autre part, le fait que ce soit le client de l’IFD qui prépare le dossier de demande de financement « rend difficile l’incorporation de facteurs de travail décent aux étapes initiales de la conception du projet », quand bien même la majorité des IFD s’engagent à appliquer des normes du travail adéquates, indique le rapport.
Selon Ortiz, dans le cas des projets de financement mixte des IFD « les bénéfices en termes de développement humain sont relativement restreints, voire nuls. Au mieux, on pourrait affirmer qu’ils ont un effet économique positif en termes de création de postes de travail, de contribution à la croissance ou d’attraction d’investissements directs étrangers ». Il nuance, toutefois, en ajoutant : « il est très habituel que ces mêmes entreprises qui bénéficient d’un financement dans le pays d’origine soient également subventionnées indirectement dans le pays de destination via des exonérations ou des allègements fiscaux ».
Le développement par l’intermédiaire de paradis fiscaux
D’après le rapport “Going Offshore” publié en 2014 par Eurodad (réseau d’ONG européennes groupées pour faire pression sur les gouvernements en vue d’une transformation du système économique et financier mondial), les IFD ont fréquemment recours aux paradis fiscaux pour canaliser leurs investissements, au lieu de faire appel aux institutions financières des pays concernés par l’aide. À titre d’exemple, l’IFD britannique CDC a envoyé, au total, 3800 millions de dollars US (environ 3400 millions d’euros) entre 2000 et 2013 vers des fonds qui opéraient à travers des paradis fiscaux. Autre exemple, à la fin de 2013, l’IFD norvégienne Norfund avait canalisé 46 de ses 165 investissements via des paradis fiscaux, pour un montant estimé à 339 millions de dollars (environ 300 millions €).
Quant à l’IFD belge BIO, le rapport indique qu’en juin 2014, celle-ci était impliquée dans un total de 42 fonds d’investissement, dont 30 étaient domiciliés dans des paradis fiscaux, et ce pour un montant estimé à 207 millions de dollars (soit environ 184 millions €).
Son porte-parole, Tom De Latte, explique que « BIO s’efforce toujours d’investir directement dans le pays ciblé », dès lors que l’institution considère le paiement d’impôts comme un facteur important du développement d’un pays. Toutefois, il s’avérerait dans certains cas nécessaire, selon lui, de recourir à un centre financier extraterritorial comme intermédiaire pour pouvoir opérer « vu l’absence à l’heure actuelle d’un cadre législatif adéquat ». Il précise, néanmoins, que pour parer à toute suspicion de pratiques frauduleuses, l’information concernant le lieu de domiciliation de ses clients est disponible via sa page web.
D’après l’EDFI, qui est citée dans le rapport conjoint RSCD-CSI/AOED, les paradis fiscaux permettent à leurs membres de « faire office de catalyseurs dans l’attraction de capitaux institutionnels au bénéfice des pays en développement, en plus de garantir que leur capital au même titre que le capital institutionnel investi conjointement soit investi en conformité avec des politiques environnementales, sociales et de gouvernance solides ». Nonobstant, Eurodad met en exergue le manque de transparence des IFD eu égard au recours à ces territoires.
Mais les IFD des pays riches ne sont pas les seules à succomber à la tentation d’un recours à des cadres juridiques laxistes pour leurs activités. D’après Ortiz, « dans certains pays en développement, des positions très ambivalentes existent s’agissant de l’évasion fiscale, alors que dans ceux où prime l’orthodoxie économique, non seulement la pression fiscale est-elle extrêmement faible mais, de surcroît, des exonérations ou des taux d’imposition extrêmement réduits sont offerts sous prétexte de maintenir un climat favorable à l’investissement direct étranger ».