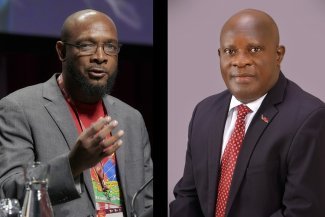Dans les vignes, les champs ou la chèvrerie, elles sont de plus en plus nombreuses à remettre en cause les pratiques familiales et locales pour travailler en cohérence avec leurs valeurs. « Je suis très admirative de la femme paysanne de la jeune génération », partage Babeth, agricultrice qui a repris et dirigé la ferme familiale de Gan, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, jusqu’à sa retraite. Pour elle, pas de doute, les femmes d’aujourd’hui font des choix ambitieux. Un constat, empirique que les institutions partagent dans leurs rapports officiels. En 2017,la Banque Mondiale mentionnait que « partout dans le monde, qu’elles travaillent dans les champs ou dans un laboratoire, les femmes sont en train de transformer l’agriculture pour la rendre plus résiliente et plus durable ».
En France, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation « les femmes sont forces motrices de développement de nouvelles activités ». Une influence vertueuse qui semble d’autant plus importante dans le contexte actuel de changement climatique. Responsable de 23 % des gaz à effet de serre selon un rapport du GIEC paru en 2019, devenue très consommatrice de produits phytosanitaires et toujours plus productiviste, l’agriculture est régulièrement pointée du doigt pour ses impacts environnementaux. L’enjeu d’un changement est grand. Pourtant, les femmes sont encore peu nombreuses à la tête de domaines agricoles. En France, seul un quart des exploitations, sont dirigées par des agricultrices
Dans le sud-ouest de la France, il y a une région qui n’a pas attendu les mouvements féministes pour permettre l’héritage des terres pour la descendance féminine. Dans le Béarn, les femmes peuvent hériter des terres familiales depuis le 11e siècle. Pour Equal Times, la journaliste Tiana Salles et la photojournaliste Victorine Alisse, toutes deux petites filles d’agriculteurs, sont parties, en juin 2020, à la rencontre de ces femmes qui produisent notre alimentation. Au fil des routes et des chemins, elles ont échangé avec des femmes de plusieurs générations, des actrices d’une agriculture vertueuse, et observé leur quotidien.

Babeth pose dans la cuisine de la ferme familiale, près de Pau. Fille de paysan, elle a repris seule une exploitation avant que son mari ne la rejoigne. Son objectif est d’abord de poursuivre l’œuvre de ses parents, basée sur la vente locale et en direct. « On avançait comme on pouvait, mais on avait une vraie reconnaissance de notre produit par les consommateurs et une fierté qui n’a pas de prix », témoigne-t-elle.
Quand elle reprend le flambeau familial en 1980, Babeth a déjà une vie professionnelle d’éducatrice derrière elle et n’a pas de diplôme agricole. Elle ne peut donc pas prétendre à toucher des aides à l’installation. De plus, les activités variées de sa ferme (élevage, culture de jonquilles, petits fruits) n’entrent pas dans les filières visées par la Politique Agricole commune (PAC) de l’Union européenne. Mais qu’importe ! L’agricultrice fait de sa singularité un atout : celui de ne pas intégrer un système qui ne lui correspond pas.
Cette paysanne engagée n’hésite pas non plus à défendre sa vision de l’agriculture en s’investissant dans un syndicat agricole. Babeth a rejoint la Confédération paysanne à laquelle elle continue de participer de temps à autre, à l’occasion de soupes solidaires ou d’action ponctuelle de protestation ou de sensibilisation dans des supermarchés. Elle milite pour la préservation de pratiques paysannes et de la vente locale. Au niveau agricole, elle raconte avec fierté : « Je suis à l’origine de la création et du développement de l’association pour le "haricot de maïs du Béarn". » Un haricot planté au côté d’une variété ancienne de maïs, afin de créer selon les principes de la permaculture une complémentarité entre les espèces et échapper ainsi à l’usage de produits phytosanitaires.

Nathalie préfère poser avec son chien qui l’accompagne dans toutes les activités de la ferme. Elle a repris cette dernière en 2005, à Rébénacq, au pied du Parc national des Pyrénées et a choisi de développer l’élevage de chèvres en agriculture biologique et la vente de fromages.
Nathalie a repris la ferme de ses parents, lorsqu’arrivés à l’âge de la retraite, ils envisagent une location des terres. « Il était hors de question que je ne puisse plus venir à la ferme ». L’agricultrice n’hésite donc pas une seconde. Peu épanouie dans sa vie professionnelle en tant qu’employée dans une conserverie de canard, elle décide de reprendre les terres familiales et de s’y installer.
Malgré son apprentissage au contact de ses parents, n’ayant aucun diplôme agricole, elle ne peut percevoir aucune aide à l’installation pour les jeunes agriculteurs (DJA). Elle entreprend alors de passer les qualifications nécessaires. Une expérience qui la marque : « Tu apprends à passer les produits chimiques, à traiter tout. Moi, j’ai refusé de suivre ce cours là ». Hors de question pour l’agricultrice de pratiquer des méthodes qui vont à l’encontre de ses convictions. Sa ferme sera donc labélisée AB - Agriculture Biologique. Cependant, Nathalie souhaite aujourd’hui aller plus loin dans sa démarche.

Dans sa ferme, Nathalie élève des chèvres, quelques vaches et des poules. Ici, Nathalie nourrit ses bêtes au petit matin. Elle tient à leur donner de l’attention : « L’animal, il a vraiment une conscience et tu peux tout savoir ».
L’agricultrice a développé une sensibilité pour l’animal au fil des années. « Quand j’ai commencé je n’en étais pas là. Mais quand tu deviens maman, il y a des choses en élevage qui ne sont plus possibles. Par exemple, séparer les chevreaux de la mère dès la naissance et les envoyer au camion [pour être engraissés ailleurs, nda] ». Un geste incontournable pour obtenir assez de lait de chèvre pour couvrir la demande du consommateur, car le chevreau prend trop de lait et la viande de che-vreau ne se vend pas vraiment en France, car cela ne fait pas partie des habitudes de consommation.
Un autre aspect qu’elle n’apprécie pas, c’est de devoir passer beaucoup de temps hors de la ferme. Nathalie pratique la vente directe sur les marchés. « La coopérative achète nos fromages à bas prix, la vente directe est plus rentable. Et cela permet un lien direct avec le consommateur ». Mais ce système à ses limites : il faut donc tout assurer. En plus du soin des animaux, de l’entretien de la ferme, de la transformation du produit, il faut assurer les tâches administratives et la vente. « La commercialisation, c’est un travail à temps plein. Concrètement, si je suis dans un réseau court, je suis obligée d’être à l’extérieur une partie du temps. ».
La ferme fonctionne, mais sans l’aide bénévole de ses parents, elle n’y arriverait pas. Avec leur avancée en âge, Nathalie souhaite évoluer et mûrie un projet depuis plusieurs mois.

Nathalie met en pot le fromage de chèvre frais qui deviendra de la tome. Si elle arrive à réorganiser son système de vente, elle réfléchit à développer l’élevage de races de chèvres plus rustiques et diversifier les productions de sa ferme.
Son projet est de créer un système où le consommateur devient partie prenante de sa ferme, un peu à l’image des AMAP, à micro-échelle. Elle souhaiterait s’engager avec des familles de manière annuelle : celles-ci achèteraient l’équivalent d’une (ou d’une demie) chèvre. Durant un an, elles perce-vraient du fromage, du lait, des yaourts… Mais aussi la viande de chevreau. Les petits ne seraient, en effet, plus séparés de leur mère dès la naissance, son but étant de le laisser vivre trois mois sous la mère. « Ce système humanise la ferme, car cela permet d’impliquer les gens », explique Nathalie. Ce qu’elle souhaite, c’est recréer un lien entre gens de la ville et de la campagne et permettre aux familles de venir à la ferme un jour par semaine.
Nathalie espère aussi devenir autonome, ne plus dépendre des aides de la PAC (Politique Agricole Commune), tout en s’assurant un revenu décent et retrouver la satisfaction du lien avec le consommateur.

En plus de la vente de miel, Hélène réalise différentes recettes de pains d’épices et biscuits et à base de miel dans son atelier. Elle vend ensuite sa production sur les marchés locaux et dans des épiceries de la région. « Faire du local, de la vente directe, faisait partie de notre socle de valeurs, c’était tellement évident ».
Cette ancienne travailleuse sociale de l’éducation populaire, a opéré une reconversion professionnelle pour rejoindre son mari Damien, qui lui était berger avant de quitter son cheptel de brebis pour celui des abeilles. Ensemble, ils créent alors leur activité à Bedous, un petit village de la Vallée d’Aspe. Pour le moment, Hélène souhaite privilégier sa vie de famille. Même si elle souhaiterait, à terme, s’occuper davantage des ruches, elle s’occupe principalement de la fabrication de produits dérivés et de la vente qui lui laissent plus de souplesse.
En s’installant dans un petit village de montagne, ils ont fait le choix d’une région éloignée des grandes cultures, qui permet de préserver leurs ruches des effets délétères de l’agrochimie. Si les ruches sont à peu près épargnées par les produits phytosanitaires, elles n’échappent cependant pas aux conséquences du changement climatique : la pluviométrie devient aléatoire et les températures atteignent régulièrement des pics. « Les abeilles ont beaucoup de mal à faire du miel », témoigne Hélène. Leur production pourra donc difficilement croître. Pour pouvoir développer leur activité, les deux agriculteurs envisagent donc plutôt d’ouvrir un espace pédagogique autour de l’abeille et du miel.

Irène, viticultrice en agriculture biologique, est née au sein du domaine Latapy, dont elle a hérité sur les hauteurs de Gan, dans le Béarn, et qu’elle continue à faire vivre aujourd’hui.
Irène tient depuis 25 ans les rênes d’une ferme typique de la région. Si ses parents y élevaient des vaches laitières, des moutons à viande et cultivaient un peu de raisins destinés à la cave coopérative, l’agricultrice, elle, a choisi d’en faire un domaine viticole à part entière. Cette descendante de « paysans laboureurs », au caractère affirmé, gère son exploitation à sa manière. « J’ai une vision très fa-miliale de l’entreprise et j’emprunte très peu ». Avoir un tracteur dernière génération ne l’intéresse pas.
Cette femme entrepreneuse aux mille idées, n’hésite pas à élargir ses activités. Chaque année, elle innove pour s’assurer des revenus sans dépendre de personne et vivre comme elle l’entend, dans un esprit de partage. « Je n’ai rien fait pour avoir ce lieu magnifique. Je veux le faire vivre et en faire profiter aux autres ». Gîte, accueil de groupes, circuits de balades, animations autour du vin et bientôt escape game, elle semble ne jamais s’arrêter. Et si certains essayent parfois de lui mettre des bâtons dans les roues, elle ne se décourage pas. « Les gens à qui je ne plais pas, je les em***** ».

En fin de journée, Irène redescend dans ses champs et rogne la vigne. Si les années passent, l’amour de la vigne reste intact. « Chaque année, j’ai l’impression d’enfanter. Il y a un vrai rapport à la maternité avec la vigne », partage Irene.
Ses 4,7 hectares de vignes, sont comme ses enfants. Un lien qui va de pair avec le respect de l’environnement. Le domaine est certifiée "bio" depuis 2012, mais Irène en applique les méthodes depuis 2003. Une philosophie qui semble lui être venue progressivement, par effet d’émulation avec d’autres viticulteurs de la région. « Je n’arrivais pas à mémoriser le nom des molécules chimiques et les formations en bio étaient intéressantes. Ça nous correspondait, point barre ». Ils essayent une année ; la seconde, ils l’adoptent et ne feront jamais marche arrière.
Un choix dont elle voit concrètement les effets : « En trois ans, on commence à en voir les effets et en 25 ans, c’est juste magnifique de voir la biodiversité qui s’est développée ». L’an dernier, elle a notamment trouvé une orchidée au pied de ses vignes. Une fleur, alors inconnue sur le domaine. Pour elle, quitte à perdre un peu de récolte, elle ne veut pas gâcher ces « trésors de la nature ».

Vers 18 heures, Jessica effectue la traite du soir. Elle est accompagnée de son apprenti et d’une stagiaire, étudiante au sein d’une école supérieure d’agro-développement, à qui elle donne des conseils pour son premier jour.
Jessica élève un troupeau de vaches jersiaises. Cette race rustique produit peu de lait, mais un lait de grande qualité, reconnu pour ses richesses nutritionnelles. L’agricultrice en fait du fromage, du lait cru et du beurre, qu’elle vend sur les tables gastronomiques de la côte basque, et même dans une clinique bordelaise pour les traitements de la peau. Un élevage atypique que l’agricultrice de 28 ans a mis en place quand elle a repris la ferme familiale en 2012. A l’époque, son père possède un troupeau de vaches de race prim’holstein, avec un contrat de vente exclusif à une laiterie coopérative. Une production qui tourne bien, jusqu’en 2008. La crise économique entraîne une chute des cours du lait. Les dettes s’accumulent et en 2012, l’exploitation familiale, pourtant en place depuis 5 générations, est au bord de la faillite.
Jessica décide alors de monter un projet de transformation globale : changement de race de vaches, changement d’alimentation des bêtes, vente directe, production fromagère. Un changement radical que sa mère encourage rapidement, mais plus difficile à accepter pour son père qui voit sa pratique de toute une vie remise en cause. Mais, même si cela doit prendre du temps, Jessica y tient, le changement doit se faire en famille. « On a complètement changé de système. On a changé la ferme et nous avec ». Aujourd’hui, la famille s’est débarrassée de ses dettes et la ferme est reconnue pour la qualité de sa production. La réussite de Jessica est donc une victoire familiale.